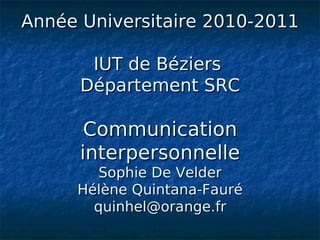
Support théorique du cours
- 1. Année Universitaire 2010-2011 IUT de Béziers Département SRC Communication interpersonnelle Sophie De Velder Hélène Quintana-Fauré quinhel@orange.fr
- 2. Historique de l’Analyse Transactionnelle Eric Berne,(1910-1970) médecin psychiatre, dès 1943, pratique la thérapie de groupe. S’inspirant des travaux de Paul Federn et d’Erik Erikson, il crée l’Analyse Transactionnelle et ,en 1964, avec ses confrères,l’ITAA ( Association Internationale d’Analyse Transactionnelle).
- 3. Dès le début Eric Berne différencie trois champs d’application de sa théorie de base de l’AT: la Psychothérapie, l’Education et les Organisations. Ce cours va développer la pratique de l’AT dans les Organisations.
- 4. Philosophie de L’AT Tous les gens sont OK Nous avons vous et moi de la valeur. Votre essence en tant qu’être humain est Ok pour moi,même si votre comportement ne l’est pas.
- 5. Tout le monde a la capacité de penser Tout le monde à l’exception des gens ayant de graves lésions cérébrales a la capacité de penser. Modèle décisionnel Ce sont les gens qui décident de leur destinée et ces décisions peuvent être changées. Même si l’environnement et les autres exercent des pressions sur nous, c’est toujours notre décision personnelle d’y céder.
- 6. Principes de Bases de L’AT Méthode contractuelle Le contrat est un engagement bilatéral explicite en vue d’une action bien définie . Le contrat est l’énoncé de la responsabilité de chacune des parties. Communication directe Les protagonistes ont tous des informations précises et claires sur ce qui se passe dans leur travail commun. Les idées de l’AT sont exprimées dans un langage simple qui permet de partager une théorie profonde et minutieusement raisonnée.
- 7. Le modèle des Etats du moi Un Etat du Moi est un ensemble cohérent de pensées et de sentiments directement associé à un ensemble correspondant de comportements. P A Diagramme E structural de premier ordre
- 8. Identifier les Etats du Moi Diagnostic comportemental En observant le comportement d’une personne , on peut identifier dans quel Etat du Moi elle se trouve. Diagnostic social Les autres sont en relation avec moi à partir d’un Etat du Moi complémentaire à celui que j’utilise.
- 9. Les transactions Une transaction est un stimulus transactionnel plus une réponse transactionnelle. C’est l’unité de base du discours social. Dans l’analyse des transactions, nous utilisons le diagramme des Etats du Moi pour nous aider à
- 10. Les transactions complémentaires Règle de communication La transaction complémentaire a quelque chose de prévisible. Tant que les transactions demeurent complémentaires la communication peut durer indéfiniment.
- 11. Transaction complémentaire A-A P P S A AA R E E
- 12. Transaction complémentaire P-E, E-P P P S A A R E E
- 13. Transaction complémentaire EL-PN, PN-EL PC PC PN PN A S A R EA EL EA EL
- 14. Transactions croisées Dans une transaction croisée, l’Etat visé,n’est pas celui qui répond . Règle de communication Quand la transaction est croisée, il en résulte une rupture de la communication,il faudra l’un des deux individus ou les deux changent d’Etat du Moi pour que la communication soit restaurée.
- 15. Transaction croisée A-A , P-E P P A S A R E E
- 16. Transaction croisée P-E, A-A P P S A A R E E
- 17. Transaction croisée EL-PN, PC-EA PC PC PN PN S A A R EA EA EL EL
- 18. Transactions cachées ( à double fond) Deux messages sont émis en même temps. L’un d’eux est ouvert , de niveau social. Le deuxième est un message caché, de niveau psychologique. Règle de communication Le comportement qui résulte d’une transaction cachée est déterminé au niveau psychologique et non au niveau social
- 19. Double Transaction cachée: Niveau social A-A, A-A; niveau psychologique P-E, E-P P P RP SS A A RS E E SP
- 20. Transaction cachée angulaire P P SS A A SP E R E
- 21. Les signes de reconnaissance Postulat: Tout être humain a besoin de signes de reconnaissance, de stimulations physiques et mentales pour son équilibre psychologique. Les signes de reconnaissance peuvent être: Verbaux ou non verbaux Ils peuvent être totalement non verbaux et toute transaction verbale porte un message corporel. ..
- 22. Positifs ou négatifs Il vaut mieux des signes de reconnaissance négatifs que pas de signes de reconnaissance du tout . Conditionnels ou inconditionnels Les signes de reconnaissance conditionnels s’appliquent à nos actions et nous permettent d’ajuster notre comportement et d’acquérir des compétences. Les signes de reconnaissance inconditionnels S’appliquent à ce que nous sommes.
- 23. Structuration du temps Définition : Chaque fois que des individus se retrouvent en groupe, ils peuvent passer leur temps de six manières différentes: -Le retrait -les rituels -les passe-temps -les activités -les jeux -l’intimité
- 24. Retrait Une personne dans le retrait échange des signes de reconnaissance qu’avec elle- même. Elle évite le « risque » psychologique de rejet qu’elle peut percevoir dans son état du Moi Enfant. Ces personnes ont tendance à stocker les signes de reconnaissance. Si cet état se prolonge, la personne peut souffrir du manque empêchant le bien-être psychologique
- 25. Rituels Ils constituent un échange de signes de reconnaissance peu intense mais ils rassurent. Leurs caractères prévisibles permettent d’éviter les risques affectifs, de gérer ses relations aux autres et à l’environnement en toute sécurité.
- 26. Passe-temps Un passe - temps , comme un rituel se déroule de manière connue mais son contenu n’est pas programmé aussi strictement . Il n’y a pas d’engagement dans l’action, mais il permet de sélectionner des partenaires éventuels avec lesquels nous pourrons échanger des signes de reconnaissances plus intenses. Il présente un peu plus de « risque psychologique » pour l’Etat du Moi Enfant.
- 27. Activité C’est la forme de structuration du temps la plus attendue dans la vie professionnelle. La communication entre les membres du groupe vise à atteindre un but, pas seulement à en parler. Les signes de reconnaissance apportés dans l’activité peuvent être à la fois conditionnels positifs ou négatifs et souvent différés en fin d’activité.
- 28. Jeux Il faut entendre par ce terme: « jeux psychologiques ». L’analyse des jeux est une partie essentielle de la théorie de l’Analyse Transactionnelle (nous développerons en détail les mécanisme des jeux psychologiques, dans un chapitre ultérieur).
- 29. Les jeux impliquent toujours un échange de méconnaissances, à la fin du jeu les deux joueurs vivent des signes de reconnaissance négatifs et une sensation d’insatisfaction. Le risque psychologique et la stimulation qui en découle est plus élevé que dans l’activité ou le passe-temps.
- 30. Intimité Nous ressentons l’intimité quand nous exprimons nos sentiments et nos désirs authentiques sans les censurer. Il n’y a pas de messages secrets , le niveau social et le niveau psychologique sont cohérents.
- 31. Les sentiments exprimés sont adaptés pour amener la situation à son terme. L’intimité n’est pas programmée à l’avance et constitue le plus imprévisible de tous les modes de structuration du temps. L’Etat du moi enfant peut percevoir l’intimité comme la manière la plus risquée d’être en relation . Paradoxalement c’est la moins risquée puisqu’elle apporte un sensation de satisfaction.
- 32. Le scénario de vie Le scénario est un plan de vie Il est constitué de décisions prises dans l’enfance en relation avec les événements vécus et les pressions parentales Il est inconscient La réalité est redéfinie pour «justifier» le scénario.
- 33. Origines du scénario Les décisions scénariques représentent la décision la plus adéquate que le tout petit ait trouvée pour survivre dans le monde qui apparaît souvent comme hostile, voire menaçant pour sa vie. Elles s’appuient sur les émotions. Un jeune enfant ne pense pas comme un adulte, il n’a pas non plus la même notion du temps, ses émotions sont ressenties avec plus d’intensité, aussi il peut prendre des décisions exagérées.
- 34. Comment se vit le scénario Une fois adultes nous rejouons quelquefois les stratégies que nous avons décidées dans l’enfance .Ces décisions souvent exagérées et inutiles dans la vie d’adulte peuvent nous envahir sans que nous en soyons conscient. Chaque individu a un scénario qui lui est propre et unique comme une empreinte digitale. Par contre le processus scénarique couvre un nombre relativement limité de schémas.
- 35. Il est impossible de savoir quand une personne entre dans son scénario. Cependant, deux facteurs contribuent particulièrement à cet envahissement scénarique: Quand la situation est génératrice de stress. Quand il existe une similitude entre la situation présente et une situation stressante de l’enfance,cette situation s’appelle un « élastique ».
- 36. Les processus scénariques Il existe six processus scénariques Avant Après Jamais Toujours Presque Sans Fin
- 37. Scénario Avant Croyance: « Quelque chose de bien ne peut arriver avant que quelque chose de moins bien ne soit terminé. » Dans la mythologie grecque, Hercule a un scénario avant. Scénario Après Croyance: « Si quelque chose de bien m’arrive, il faudra que je le paie demain. » C’est le mythe de Damoclès. Scénario Jamais Croyance: « Je ne peux jamais obtenir ce que j’aime le plus » Mythe de Tantale
- 38. Scénario Toujours Croyance: « Pourquoi est-ce que cela m’arrive toujours à moi? » Mythe d’Arachnée. Scénario Presque Croyance: « J’y suis presque arrivée, mais il me manque quelque chose » Mythe de Sisyphe. Scénario Sans Fin Croyance: « Une fois atteinte une certaine période de ma vie, je ne saurai plus quoi faire de moi. » Mythe de Philémon et Baucis.
- 39. Comment sortir des schémas de processus scénariques ? C’est en gardant la conscience de l’Adulte et en mettant en œuvre un comportement qui va à l’encontre de notre processus scénarique que nous affaiblissons ce schéma pour l’avenir.
- 40. Les positions de vie Chacun de nous atteint l’âge adulte en ayant écrit son scénario à partir de l’une de quatre positions de vie bien que nous ne restions pas dans cette position de vie, que nous en changeons souvent, nous avons tous un cadran privilégié. Vous + Moi - Position ++ attitude Moi + Position - + attitude saine dépressive Position - - attitude Position + - attitude futile paranoïde Vous -
- 41. Les sentiments parasites Ils sont aussi appelés sentiments rackets. Définition: C’est une émotion habituelle, apprise et encouragée dans l’enfance, vécue dans de nombreuses situations de stress et inappropriée comme moyen Adulte de résoudre les problèmes. Chaque fois que nous éprouvons un sentiment parasite, nous sommes dans notre scénario.
- 42. Le sentiment parasite se substitue à un sentiment authentique qui était interdit, ou que nous avons interprété comme tel, dans notre enfance. Les sentiments authentiques sont reliés aux quatre émotions principales: - la colère - la tristesse - La peur - la joie
- 43. L’expression de ces sentiments parasites aboutit immanquablement au même résultat insatisfaisant. On peut éprouver la satisfaction passagère d’avoir extorqué des signes de reconnaissance à son environnement , mais, le besoin sous- jacent qui aurait été traité en exprimant le sentiment authentique n’est jamais satisfait.
- 44. Les timbres Quand nous éprouvons un sentiment parasite, nous pouvons en faire deux choses, soit: l’exprimer sur-le-champ ou bien le mettre en réserve pour nous en servir plus tard. On dit alors que nous collons un timbre. A l’instar des carnet de timbres achats, je peux ainsi coller des « timbres cadeaux psychologiques » et les rendre de façon massive et inadaptée à la résolution du problème.
- 45. Les jeux psychologiques Les jeux sont répétitifs. Chaque personne joue le schéma de son jeu préféré de manière répétée dans le temps. Les jeux se jouent hors de la conscience Adulte. Les jeux aboutissent toujours au fait que les joueurs éprouvent des sentiments parasites. Ils impliquent un échange de transactions cachées entre les joueurs. Les jeux comportent toujours un moment de surprise ou de confusion.
- 46. Le triangle dramatique Stephan Karpman a conçu un triangle simple et puissant d’analyse des jeux. Persécuteur Sauveteur P S Victime V
- 47. Un persécuteur est quelqu’un qui rabaisse les autres et les humilie et pour qui les autres sont inférieurs et non OK. Un sauveteur voit également les autres comme non OK et inférieurs, mais il réagit en proposant de l’aide à partir d’une position supérieure. Une victime se sent inférieure et non OK. Tous les acteurs du triangle utilisent de vieilles stratégies scénariques qu’ils ont décidé enfants ou modélisé sur celles de leurs parents.
- 48. Les méconnaissances Chaque fois que nous sommes confrontés à un problème, nous avons deux options: soit utiliser notre capacité Adulte de penser , de sentir et d’agir. soit passer dans notre scénario. En choisissant la deuxième option, je me mets à percevoir le monde de manière à ce qu’il cadre avec les décisions que j’ai prises enfant. Je compte alors sur « la solution magique » que me propose mon scénario et je deviens passif.
- 49. Les quatre comportements passifs Quatre types de comportements indiquent sans conteste qu’une personne est dans une méconnaissance: L’abstention La suraptation L’agitation Le blocage ou la violence
- 50. L’abstention: C’est le ne rien faire, au lieu d’utiliser notre énergie pour résoudre un problème, nous l’utilisons pour nous empêcher d’agir. Nous méconnaissons alors notre capacité à penser, sentir ou agir. La suradaptation: Quand nous nous plions à ce que nous croyons dans l’Enfant , être les désirs des autres, sans vérifier avec eux quels sont vraiment leurs désirs et sans ce référer à nos propres désirs. Nous méconnaissons , alors notre capacité à agir selon nos propres choix.
- 51. L’agitation: Quand nous nous engageons dans une activité sans objet et répétitive pour essayer de calmer notre sensation de mal être La méconnaissance à l’œuvre est celle de ne pas croire à notre capacité de résoudre un problème précis. Le blocage ou la violence: Ils suivent souvent une période d’agitation. L’énergie engrangée lors de l’agitation est libérée de manière destructrice. Le blocage peut se manifester sous forme d’affections somatiques.
- 52. Méconnaissance et Etats du Moi La méconnaissance peut révéler la présence d’une contamination d’un Etat du Moi par un autre. Elle peut aussi se manifester par l’exclusion d’un des Etats du Moi.
- 53. Repérer les méconnaissances Le surdétail. La généralisation. La répétition de certaines formules: « Je vais essayer… » « Je ne peux pas ». L’absence de précision dans l’expression d’un souhait. Les indications non verbales révélant l’incongruité. Le « rire du pendu ».
- 54. Les Emotions Définition de l’émotion: C’est une séquence de changement d’état qui intervient à la fois sur le plan neurobiologique et moteur. Sa durée est brève, les réactions sont rapides et passent toujours par le corps. Utilité des émotions: Pour soi, c’est un indicateur que quelque chose se passe, d’un changement pour faire face à ce qui arrive.
- 55. Par rapport à l’autre et dans l’interaction, elle a une fonction d’orientation de la conduite, permet d’ajuster la communication en prenant en compte les indices montrés par le corps (mimiques, gestes, comportements). Au niveau social, les émotions et les comportements vont être standardisés pour permettre au groupe d’adopter des comportements comparables qui favorisent sa cohésion.
- 56. Définition du sentiment: Le sentiment est un état affectif complexe, relativement stable qui mêle émotions et pensées, qui persiste en l’absence d’un stimulus ou déclencheur. Il passe par la pensée; après avoir ressenti une émotion, on ressent au fond de soi un sentiment qui lui serait associé. Définition de l’humeur: L’humeur est liée aux émotions mais s’en distingue par la durée; elle peut persister plusieurs jours, son déclencheur n’est pas identifié; elle fait référence à une tonalité affective qui envahit la personne.
- 57. Tableau du trajet des émotions Ce tableau, élaboré par Carlo Moïso, psychiatre italien, médecin spécialiste en psychopathologie, permet d’identifier les quatre émotions primaires, leur implication corporelle et les comportements qu’elles engendrent afin de retrouver un état de stabilité et de confort psychique.
- 58. le trajet des émotions Niveau Niveau cognitif Niveau Comportement primitif Comportement évolué Manifestation kinesthésique Pensée émotionnel action individuelle Action sociale Danger Inconfort Demande d'aide, Manque de Peur Fuite (malaise) de protection limites Ouverture de la Dommage Demande de Gestalt régie par le Inconfort Etre Colère Lutte contre Attaque changement, système (malaise) endommagé de réparation orthosympathique Retrait Demande Inconfort Perte Tristesse Repli et élaboration de réconfort, de (malaise) Séparation du deuil consolation d'amour Fermeture de la Gestalt régie par le Confort Maintien de la Demande de partage Présence Joie système (plaisir) situation d'ouverture Faire part parasympathique
- 59. La Communication Emotionnelle Non Violente ou Assertivité Le psychologue Marshall Rosenberg, né à Détroit dans un quartier pauvre et particulièrement violent, s’est passionné très jeune pour les façons intelligentes de résoudre les différends sans passer par la violence. Il a élaboré une carte à six points: La carte SPACEE qui donne de meilleures chances d’obtenir ce que nous souhaitons, alternative à la
- 60. S pour SOURCE: S’assurer que la personne à laquelle on s’adresse est bien la source du problème et qu’elle a les moyens de la résoudre. P pour PLACE et MOMENT: Il faut toujours veiller à ce que la discussion se déroule dans un endroit protégé et privé, et à un moment propice. A pour APPROCHE AMICALE: Pour se faire entendre , il faut d’abord s’assurer que l’on va être écouté, proscrire le ton péremptoire, s’adresser à la personne en prononçant son nom ou prénom (« Phénomène du cocktail »).
- 61. C pour COMPORTEMENT OBJECTIF: Décrire de façon le plus neutre possible ce qui se passe , sans jugement. E pour EMOTION: La description des faits doit être immédiatement suivie par l’émotion que l’on a ressentie. Parler en nom propre: Utiliser le JE. E pour ESPOIR DEÇU ou le besoin que l’on ressent et qui n’a pas été satisfait.
